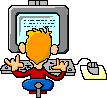|
réalisé par les élèves de 1ère de l'option musique . |
1) Origine du menuet, par Lisa  et Aurélien
et Aurélien 
2) Le menuet baroque, par Cécile 3) Le menuet classique, et...
5) Conclusion EN GREVE |
|
I) Origine du menuet Le menuet apparut en France au début du XVIIème siècle. Il semble originaire du Poitou, mais certains le disent originaire de l’Anjou. A cette époque, plus encore qu'à d'autres, la France était le pays de la danse, de la chorégraphie. On dansait beaucoup, dans toutes les couches de la société, on assistait à des ballets ou des opéras dans lesquels la danse jouait un grand rôle. C’est avec Jean-Baptiste Lully, compositeur officiel du Roi Soleil, que le menuet connaît son heure de gloire. Il est très apprécié par Louis XIV. D'une part le souverain adore danser, et d'autre part le menuet, par ses caractéristiques rythmiques (voir ci-dessous), permet une chorégraphie noble et imposante qui sert ses visées politiques : le faste de Versailles, son éclat artistique doit éblouir et impressionner les cours d'Europe. Par la suite, le menuet se répand dans toute l’Europe (Allemagne, Angleterre, Italie). Il traversa la Révolution française sans problèmes. Parallèlement à sa fonction de musique de danse, le menuet
fut utilisé par les compositeurs comme danse stylisée.
Le menuet se caractérise par un rythme ternaire (mesure à 3/4) dans lequel le premier temps est nettement marqué. Le tempo est assez rapide, mais la chorégraphie, les mouvements, sont basés sur les mesure (sur les blanches pointées), ce qui en fait une danse finalement assez lente, d'où l'impression de noblesse et de sérénité que dégage le danseur de menuet. C'est cet aspect qui a particulièrement séduit Louis XIV. D'une danse populaire, le menuet est donc devenu une danse stylisée
qui a inspiré les plus grands compositeurs. Ceux-ci ont continué
à le faire évoluer au fil du temps. Certaines de ses caractéristiques
ont perduré, d'autres ont au contraire beaucoup changé. La
suite de ce dossier va s'attacher à tracer les grandes lignes de
cette évolution.
|
|
II) Le menuet baroque A) Structure : Le menuet baroque est de structure binaire, organisé en 2 parties avec reprise : AA/BB. Il se compose d’une partie qui commence par la tonique et qui se termine par la dominante. Il s'agit soit d'une demi-cadence, soit d'une vraie modulation dans la tonalité de la dominante. La seconde partie est construite sur une thématique différente de la première, et elle commence par la dominante pour finir à la tonique. B) Rythme : Comme la danse dont il est originaire, le menuet stylisé se caractérise par un rythme à 3 temps (mesure à 3/4) dans lequel le premier temps est nettement marqué. Les thèmes sont souvent organisés selon une carrure de quatre à huit mesures. Le tempo, assez vif, et ses rythmes simples en font une pièce légère et dynamique. C) Le menuet dans la suite : Rappelons qu'à l'origine le menuet est une danse campagnarde à trois temps. Cette danse devint une danse de cour sous Louis XIV. Au fil des époques le menuet ne va plus être une danse mais il va être introduit comme mouvement pour la suite. La suite est une succession de danses véritables ou stylisées. Ce sont surtout des danses françaises qui sont dans la même tonalité. A la cour, on la désigne sous les noms de pavane et gaillarde ou de pavane et saltarello. Le menuet est intégré au XVIII siècle dans la suite, entre la sarabande et la gigue. Puis au fil des années la courante s’efface et il ne reste comme cadre à la suite que :
D) Exemples de compositeurs de menuets baroques : Lully (Jean-Baptiste) est un violoniste et compositeur italien, naturalisé français qui introduit le menuet à la cour de Louis XIV au milieu du XVII siècle. Il en met dans ses ballets et ses opéras. Bach (Jean-Sébastien) est un compositeur allemand qui écrivit
des menuets baroques dans ses suites pour orchestre ou pour violoncelle.
Dernier exemple de menuet baroque, tiré d'une suite pour luth écrite par un compositeur allemand peu connu en Ardèche, Weiss (Sylvius-Leopold) : . |
|
III) Le menuet classique A) Structure : Le menuet classique a une structure ternaire, qui est généralement
: un menuet (un thème avec une reprise, puis un jeu autour du thème
et un retour au thème), puis viens un trio qui est différent
du thème, et enfin revient le menuet sans aucune reprise cette fois–ci.
Ceci nous donne donc : menuet / trio / menuet.
B) Rythme : Comme le menuet baroque, le menuet classique a un tempo modéré.
Il y a des motifs de 4 et 8 mesures tout comme le menuet baroque. C’est
un morceau à 3 temps par mesure (chiffre : 3/4 ). Il est cependant
plus lent que le menuet
C) Le menuet dans la sonate : A l’époque baroque, le menuet s’intégrait dans la suite de danse (morceau composé de danses stylisées). Mais la suite va être remplacée au XVIIIème siècle par la sonate. Le menuet va s’intégrer à cette forme et va être la seule ancienne danse de la Cour à survivre. La sonate étant de coupe ternaire, le menuet va devoir évoluer et devient ternaire. C’est pour cela que le menuet classique est ternaire. Le menuet constitue le troisième mouvement de la sonate et est destiné à procurer un divertissement. D) Exemples de menuets classiques : On peut trouver cette forme dans les symphonies classiques (sortes de
sonates d’orchestre) comme les symphonies n° 29 ou 39 de Mozart.
Voici par exemple le début du menuet du célèbre
quatuor L’empereur :
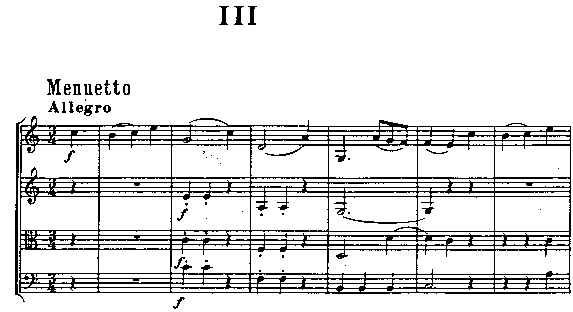
Mesure à 3/4, 1er temps bien marqué, autant dans l'écriture du thème au 1er violon que dans l'accompagnement : les caractéristiques de base du menuet sont bien présentes. .
.  |
|
IV) Le déclin du menuet A) Avec Beethoven, le scherzo remplace le menuet : Le scherzo, mot italien signifiant « plaisanterie » ou «
jeu », est une pièce instrumentale rapide et légère
constituant le second ou le troisième mouvement d’une composition
plus importante telle qu’une sonate, une symphonie ou un quatuor à
cordes.
B) Les derniers des menuets : Malgré cette quasi disparition du menuet, certains compositeurs
continuent néanmoins à en écrire :
Presque un siècle plus tard, Ravel, dans le Tombeau de Couperin,
rend un hommage à cet homme et donc reprend la forme traditionnelle
du menuet, dans une démarche néo-classique.
. |
|
V) Conclusion EN GREVE |
 et Antoine
et Antoine 
 Sandrine
Sandrine  et Patrice
et Patrice